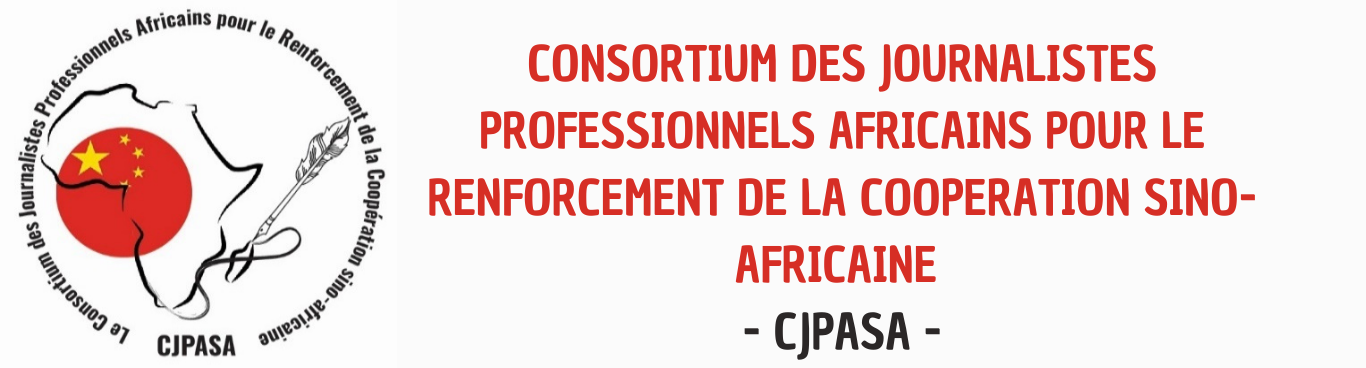Lors d’une récente réunion ministérielle tenue à Changsha, Pékin a fait part de son intention d’approfondir son engagement économique en Afrique à travers une annonce marquante : l’éventuelle suppression des droits de douane sur les exportations en provenance de 53 pays africains — exception faite de l’Eswatini, seul État du continent entretenant encore des relations diplomatiques avec Taïwan. Si certains médias se sont empressés de présenter cette initiative comme actée, il convient de noter qu’il ne s’agit, pour l’heure, que d’une ouverture de principe, conditionnée à des négociations futures et à la mise en place d’un nouveau cadre de coopération.
Ce cadre, baptisé Partenariat économique Chine-Afrique pour un développement partagé, semble constituer l’épine dorsale de la nouvelle stratégie chinoise sur le continent. Il se positionne comme une vision de long terme des échanges sino-africains, dans la continuité des annonces formulées lors du dernier Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC), en septembre à Pékin.
Une inspiration européenne aux accents chinois
La dénomination et les ambitions du partenariat proposé rappellent, dans une certaine mesure, les accords ACP entre l’Union européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ces derniers, structurés autour des axes commerce, développement et dialogue politique, avaient notamment donné naissance à l’Accord de Cotonou en 2000. Celui-ci garantissait un accès libre de droits au marché européen tout en permettant aux pays africains de préserver certains secteurs économiques sensibles. Toutefois, ces accords n’ont pas toujours tenu leurs promesses, notamment à cause de leur complexité et des disparités de développement entre partenaires.
En s’inspirant de cette approche, la Chine entend, à son tour, proposer un mécanisme d’intégration économique, mais dans un contexte profondément différent — tant sur le plan politique qu’institutionnel. Contrairement à l’Union européenne, Pékin privilégie des partenariats pragmatiques, souvent bilatéraux, et axés sur des intérêts stratégiques précis.
Des conditions implicites et des attentes de réciprocité
La proposition chinoise, bien que formulée dans le cadre du FOCAC, ne se limite pas à un geste symbolique d’ouverture. Elle implique des engagements réciproques. Comme le précise la Déclaration de Changsha et celle de Beijing en 2023, toute extension du régime zéro-droit dépendra de la signature d’un accord-cadre formel. Ce dernier pourrait comporter des clauses contraignantes, notamment en matière de protection des investissements chinois.
À ce jour, aucun pays africain ne s’est encore publiquement prononcé sur cette proposition. Il est donc difficile d’évaluer la réception réelle de l’initiative. Cependant, plusieurs éléments laissent penser que les négociations, si elles s’ouvrent, seront complexes et devront prendre en compte des enjeux économiques, politiques et diplomatiques profonds.
Un commerce déséquilibré et des défis structurels
Le commerce entre la Chine et l’Afrique demeure profondément asymétrique. Le continent exporte principalement des matières premières (pétrole, minerais, bois), tandis qu’il importe en masse des produits manufacturés chinois à bas prix. Cette structure commerciale pourrait être accentuée si les importations africaines bénéficient de réductions tarifaires, sans que les économies locales puissent, en retour, tirer profit d’un meilleur accès au marché chinois.
Déjà, la suppression des droits de douane pour 17 pays africains les moins avancés n’a pas entraîné de changement significatif dans les volumes d’échange. En réalité, la plupart de ces nations ne disposent pas des capacités de production nécessaires pour répondre à la demande du marché chinois.
D’autre part, une ouverture totale des frontières aux produits chinois pourrait nuire gravement aux industries locales, menacer des milliers d’emplois et réduire les recettes fiscales issues des droits d’importation — des ressources cruciales pour de nombreux États africains.
Une leçon venue de l’Europe
L’expérience des Accords de partenariat économique (APE) de l’Union européenne offre un précédent éclairant. Ces accords, favorables en théorie, ont souvent été critiqués pour leur mise en œuvre déséquilibrée. De nombreux pays africains y ont vu un risque pour leurs industries naissantes et leur souveraineté économique. Le Nigeria, par exemple, s’était opposé à leur signature dans le cadre de la CEDEAO, invoquant la nécessité de protéger ses producteurs locaux.
La Chine pourrait se heurter à des réticences similaires. Ses produits, largement compétitifs, dominent déjà les marchés africains. Une libéralisation commerciale supplémentaire pourrait aggraver cette situation au détriment de la production locale.
Une équation à multiples inconnues
L’adhésion des pays africains au projet chinois pourrait être freinée par quatre préoccupations majeures :
-
Faible capacité industrielle : Peu de pays africains sont aujourd’hui en mesure de profiter réellement d’un accès facilité au marché chinois.
-
Perte de revenus douaniers : Dans de nombreuses économies, les droits de douane représentent une part importante des recettes publiques.
-
Risque de désindustrialisation : Des États comme l’Afrique du Sud ou le Nigeria, à l’industrie relativement avancée, redoutent une concurrence chinoise accrue.
-
Conflit avec les dynamiques régionales : La mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pourrait entrer en contradiction avec un accord bilatéral d’envergure avec la Chine.
Pourtant, une opportunité réelle réside dans le développement industriel partagé. Si la Chine consentait à renforcer ses investissements en Afrique, à transférer certaines technologies ou à soutenir des coentreprises, un nouveau modèle de partenariat pourrait émerger, plus équitable et plus durable.
La Déclaration de Beijing avait d’ailleurs exprimé l’intention de Pékin d’accompagner l’industrialisation africaine, à condition que des garanties solides soient mises en place pour sécuriser ses investissements.
Une question de méthode et de volonté
La Chine, fidèle à sa stratégie diplomatique, privilégie les approches bilatérales. Mais cette méthode pourrait se heurter à des limites structurelles : les petits États africains ne suscitent qu’un intérêt modéré, tandis que les grandes économies se montrent prudentes face à une intégration commerciale trop rapide.
Pour éviter les erreurs commises par l’Union européenne, Pékin devra non seulement proposer un cadre attractif, mais aussi construire un climat de confiance et d’équilibre. Cela suppose des négociations transparentes, un soutien concret au développement des capacités productives africaines et une adaptation aux réalités du continent.
En définitive, la question est la suivante : la Chine parviendra-t-elle à bâtir un partenariat gagnant-gagnant avec l’Afrique, là où l’Europe a souvent échoué ? Tout dépendra de sa capacité à aller au-delà des promesses commerciales pour proposer un véritable accompagnement au développement. Mais aussi de la lucidité et de l’unité des pays africains dans la définition de leurs intérêts stratégiques.
Sans cela, cette nouvelle initiative pourrait, une fois de plus, se solder par un potentiel inexploité — et par une occasion manquée d’écrire une autre page de la mondialisation.
SRce: VitrineduCameroun